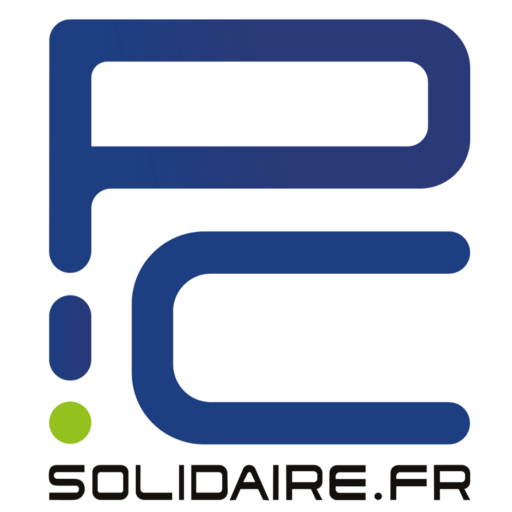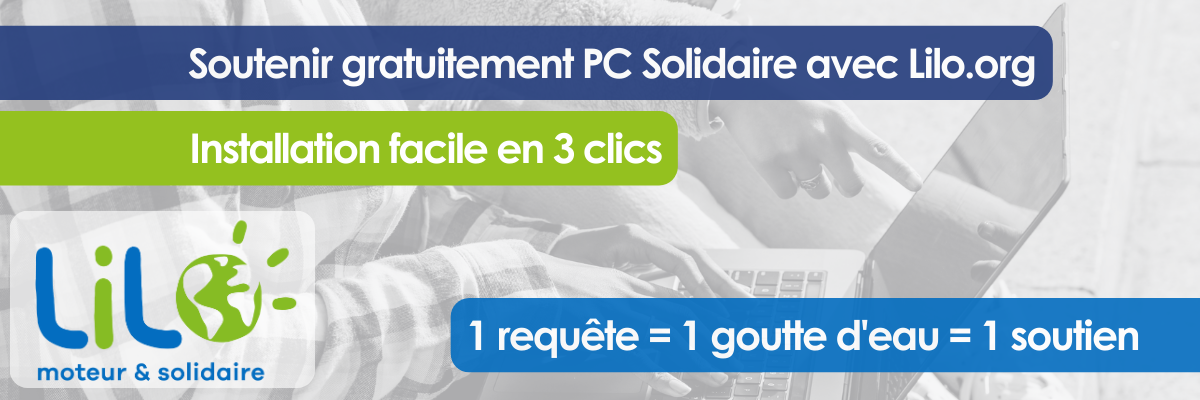Le portrait du mois
Le portrait de mars – Mathilde Heckel, coordinatrice générale de Graoucoop

« Trouver sa liberté dans l’émancipation de l’autre »
Coordinatrice générale de Graoucoop, Mathilde Heckel a accepté de venir à ma rencontre pour ce quatrième format « le portrait du mois ». Diplômée de Sciences Po, intervenante à l’IRTS, cheffe de projet à la Cravate solidaire… à 32 ans, Mathilde a déjà cumulé plusieurs vies professionnelles, de bons indicateurs de son envie continuelle d’apprendre. Elle embarque désormais dans la grande aventure Graoucoop à quelques jours de l’ouverture du supermarché coopératif de Metz.
Originaire de Peltre dont elle s’est éloignée pour ses études, Mathilde est aujourd’hui revenue dans son village d’enfance. Bac en poche, bonne élève, intéressée par de nombreux domaines et surtout désireuse de continuer à apprendre, elle arrive sur le campus franco-allemand de Sciences Po à Nancy pour deux ans. S’en suivent un an d’Erasmus à Munich puis un Master recherche en sociologie sur le campus Sciences Po parisien. La vie à la capitale « c’est compliqué » et la solitude du mémoire de recherche s’y ajoutant, Mathilde choisit de ne pas poursuivre en doctorat et revient à Peltre « J’étais un peu perdue, mon master n’est pas un diplôme qui dit concrètement je vais faire tel métier ». Après des hésitations, elle se lance « il fallait que je teste, que j’essaie ce qui se présentait ». Pendant près d’un an et demi, elle enseigne alors l’allemand en collège et débute en parallèle des interventions à l’Institut régional du travail social (IRTS) : « J’ai un premier cours sur les théories de la justice sociale et un second sur le concept de précarité et d’exclusion sociale. Comment mesurer la statistique de la pauvreté et les différentes manières de la définir ». En dehors de ses heures d’enseignement, elle s’engage comme bénévole dans une association avec des ami(e)s afin de créer une communauté d’échanges et de solidarité, notamment entre femmes. En 2020, elle devient cheffe de projet pour la toute nouvelle antenne messine de la Cravate Solidaire où elle travaillera trois ans.
L’envie d’ailleurs – la rencontre avec Graoucoop
Après trois ans à la Cravate solidaire, Mathilde souhaite « voir un autre secteur que l’insertion professionnelle ». L’offre d’emploi de Graoucoop ne tarde pas non plus à se présenter pour l’ouverture du supermarché rue André Malraux à Metz « C’était un peu le destin ! Au moment où je cherche quelque chose de nouveau, Graoucoop recrute. » Convaincue d’aller à l’entretien d’embauche « au moins pour essayer » par son entourage, elle est très vite rassurée par l’équipe sur place : il n’y a pas besoin d’avoir travaillé dans un supermarché au préalable, l’apprentissage se fera ensemble et les missions se rapprochent de la gestion de projets qu’elle connaît déjà bien. Coup de cœur pour l’équipe, missions lui donnant l’occasion d’apprendre encore sur un nouveau secteur : Mathilde n’hésite pas. Depuis un mois (et quelques jours à la publication de ce portrait) elle est maintenant l’une des coordinatrices générales de Graoucoop (les salarié(e)s ont tous le même intitulé de fonction). Leur temps est divisé en deux : responsable de magasin d’abord, incombant d’être sur place pour accompagner les coopérateurs venant effectuer leur service (lire encadré fonctionnement de Graoucoop ci-dessous) et une seconde relative au développement global du projet se déclinant sur tous les domaines : communication, comptabilité, pilotage financier etc.
Sa vision – Graoucoop, un outil pour comprendre et construire ensemble
Pour Mathilde, Graoucoop permet de retrouver de l’autonomie sur un pan de notre vie qui nous concerne tous. C’est un à la fois la construction collective d’un projet et la possibilité de comprendre le fonctionnement d’un magasin ; entrer en relation avec des fournisseurs, choisir les produits à commander, remplir les rayons… « C’est vraiment (re)prendre le pouvoir sur l’alimentation ». Ce qui a attiré Mathilde dans le projet Graoucoop, c’est, outre la possibilité de découvrir le secteur de l’alimentation, son fonctionnement horizontal « On réfléchit ensemble, on se consulte sur nos tâches respectives, on est autonomes sur notre organisation de travail. Cette manière de fonctionner prend forcément souvent plus de temps mais c’est aussi responsabilisant. Mais c’est enrichissant, pour moi, ce sont des expériences qui sont assez rares dans le milieu professionnel. »
Rendre l’alimentation accessible à tous
A Graoucoop, le choix a été fait de ne pas s’imposer de charte de produits « de type que du bio, que du local, que du éthique etc. Ce qui serait très bien, on est d’accord mais rendrait aussi les produits plus chers et donc fermerait la possibilité à des clients potentiels de venir acheter chez nous. La justice sociale est une valeur trop importante pour Graoucoop, on n’a pas envie de devenir un endroit où ne se retrouvent que les personnes ayant les moyens de le faire. Le supermarché doit devenir au contraire un lieu où tout le monde se mélange, quels que soient les budgets, les convictions ou choix alimentaires ». Si au départ, le noyau dur de bénévoles qui s’est constitué autour du projet gravitait effectivement dans les milieux associatifs, militants, aujourd’hui ce spectre s’élargit. « En devenant autonomes et en maîtrise de son alimentation avec Graoucoop, on entre aussi dans cette notion importante de participation à la vie publique que tout en chacun peut rejoindre. »
Avec PC Solidaire…
La fin de cette discussion en vient aux liens qui se sont noués entre Graoucoop et PC Solidaire. En décembre dernier, Graoucoop a en effet réalisé l’achat d’ordinateurs portables pour ses salarié(e)s mais aussi d’écrans tactiles destinés aux caisses, à la pesée des fruits et légumes et à un écran d’accueil. Cet achat avait été anticipé pour le réaliser durant notre opération de Noël « PC Solidaire fête vos dons » pendant laquelle nous doublions les dons générés par les achats de nos clients. Graoucoop a donc permis le don de 20 ordinateurs grâce à cet achat de matériel informatique reconditionné solidaire. « J’avais connu PC Solidaire quand j’étais à la Cravate solidaire et nous avions déjà acheté chez vous à ce moment-là. L’écosystème du numérique a vraiment gonflé sur cette période post-covid. Sur l’aspect matériel dont vous vous occupez, si tout le monde a plus ou moins un smartphone aujourd’hui, les pc, c’est moins évident. On a ce stéréotype que les jeunes savent tous magiquement se servir de n’importe quel outil numérique… alors qu’en vrai non ! C’est super de savoir qu’on a un partenaire local, à Metz, pour tout ce qui est dépannage et acquisition de matériel informatique reconditionné. » Pour la suite de ce partenariat, je vous annonce en exclusivité un prochain point de collecte de matériel informatique hors d’usage à Graoucoop (mais laissons-leur le temps d’ouvrir le supermarché d’abord !).
Une citation de conclusion
La puissance du collectif et l’épanouissement que Mathilde rencontre à Graoucoop, c’est ce qui revient dans la citation qu’elle a choisie à l’occasion de ce portrait : « La liberté des autres déplie la nôtre », extraite du roman de science-fiction Les Furtifs d’Alain Damasio. « Cette citation souligne l’importance de notre interdépendance collective : l’émancipation de l’autre n’est pas un danger, on peut y puiser de la joie et y trouver aussi notre propre liberté. »
A l’issue de la rédaction de ce portrait, je retrouve dans les mots de Mathilde l’écho de ceux de Sophie Bodin, PDG de Lilo.org, qui s’était elle aussi livrée à l’exercice au mois de juin 2023. Puissance du collectif, liberté de « danser avec ses chaînes », engagement social… Graoucoop et Lilo, Mathilde et Sophie, deux partenaires de PC Solidaire pourtant distincts, sur des secteurs d’activité différents mais dont les fortes valeurs s’entrecroisent… Dire seulement notre fierté de graviter dans cet écosystème de partenaires solidaires et responsables et de pouvoir nous en inspirer serait un doux euphémisme.
Margaux Lidoine
Encadré – le fonctionnement de Graoucoop expliqué par Mathilde
« Graoucoop est une coopérative. C’est un magasin de distribution alimentaire. La particularité, c’est que ce magasin appartient à ses clients et à toutes personnes membres du projet, qu’on appelle les coopérateurs (ce peut être les clients, les fournisseurs, les salariés, les partenaires de l’Economie sociale et solidaire). Ils possèdent tous une part de Graoucoop. On a cet outil de distribution alimentaire qui nous appartient et pour lequel on fait nos choix : chaque coopérateur peut apporter quelque chose en demandant à vendre tel produit, à ajouter ajoute telle référence etc. Tout le monde a une voix engagée dans le projet. En contre-partie, on demande à chaque coopérateur de participer au fonctionnement du magasin en effectuant un service de trois heures minimum par mois (selon les créneaux horaires, tenir la caisse, réceptionner les produits, remplir les rayons etc.). L’objectif, c’est d‘avoir un vrai sentiment d’appartenance avec le magasin, donc d’en prendre soin comme de chez soi, tout en faisant monter les personnes en compétences ensemble.
On a aussi les cercles, des groupes de coopérateurs qui ont éclos d’eux mêmes pour s’occuper de sujets spécifiques. On y travaille ensemble entre salariés et coopérateurs bénévoles. Par exemple, pour la comm’ je vais prendre en charge ce qui va demander plus d’heures de travail parce que je suis à 35 heures par semaine. Mais il y a aussi dans le groupe des coopérateurs bénévoles qui vont designer le flyer ; l’enseigne de la devanture a été désignée par quelqu’un du cercle comm. Parmi les autres cercles, il y a le cercle accueil qui fait toutes les réunions pour les nouveaux arrivants, le cercle vie coop qui organise les événements, le cercle cohésion qui maintient la culture de la coopération dans le groupe, le cercle approvisionnement qui organise la suggestion de nouveaux produits par rayons, le cercle informatique qui choisit les outils et assure leur installation et leur maintenance, le cercle RH qui traite les obligations légales de la coopérative envers ses salariés, etc. Et puis, il y a l’organe décisionnaire qui est le conseil coopératif, où des coopérateurs sont élus en fonction de leur collège (usager, salarié, fournisseur, etc.), représentant l’ensemble des coopérateurs pour prendre les décisions. » En savoir +
Le portrait de décembre : Linux, collaborateur au cœur de PC Solidaire
Apparu sur le petit écran de France 3 Grand Est en octobre, cité dans le Républicain Lorrain en novembre, il en deviendrait bientôt connu comme le loup blanc. Linux, mascotte de PC Solidaire aux multiples casquettes, lui valant un agenda très chargé, a humblement accepté d’être le troisième « Portrait du mois ». Une exclusivité PC Solidaire, monnayée au passage, d’un croissant tout de même…
Il fait partie des murs de PC Solidaire et sa réputation n’y est plus à faire : rares sont ceux venus en rendez-vous chez nous qui n’ont pas eu l’occasion de le grattouiller par la même occasion. Acteur des réunions d’équipe – surtout quand il y a des viennoiseries au milieu de la table – il a accompagné le projet PC solidaire quand il n’en était encore qu’au stade d’ébauche. « C’est un peu aussi mon projet. Je m’assure quotidiennement tout s’y passe bien et que tout le monde s’y sente bien. » Vigile de l’atelier, assistant RH veillant au grain que les pauses soient prises – « marcher 10.000 pas par jour au grand air, c’est vivifiant et bon pour la santé ! » – adjoint opérationnel, second du pôle communication, animateur de réunions – pas toujours pour le bonheur olfactif de tous – il est au cœur de PC Solidaire. « Je suis comme nos ordinateurs, un chien reconditionné. » Adopté à la SPA en 2021 par Martial Morvan, notre délégué opérationnel, Linux tait sa vie d’avant : « Ce qui compte vraiment, c’est l’instant présent. S’il y a des pains au lait, des câlins et des promenades où je peux faire courir la personne qui tient ma laisse : je suis heureux. Comme dirait Balou, il en faut peu… » Des paroles bien sages à méditer.
Jongler avec toutes ses fonctions, c’est « les pattes dans la truffe, de la rigolade ». Il apprend tous les jours et grandit avec PC Solidaire. « Le moins drôle, c’est la gestion de stock. P2 et Cédric, nos techniciens, passent leur temps à tout bouger ! D’un jour à l’autre, l’agencement de l’atelier n’est plus le même et des obstacles apparaissent sur mon trajet. C’est pas toujours simple de s’y retrouver. » Heureusement, il a son lieu sacré : le canapé des espaces communs. « 20mn de sieste, par ci, par là, à appliquer plusieurs fois dans la journée et je repars plus en forme que jamais ! »
Ce qu’il aime le moins, c’est quand son maître part « Il n’y a soit disant que trois places dans la camionnette pour la récupération de matériel informatique auprès des entreprises et je dois garder l’atelier. Je pense que c’est une fausse excuse, ils ont peur que je leur fasse de l’ombre. » Dans ces moments d’attente où il erre comme une âme en peine, il s’est fait une place au service communication, où il a récemment été promu second. « La responsable comm, je la mène par le bout du nez. Elle me file toujours un truc à manger et en plus n’en rate pas une pour parler de moi : à la presse, sur les réseaux sociaux, même dans les diaporamas de présentation officiels ! Après… je me méfie, ça fait quelques jours qu’elle me regarde en rigolant à l’approche de notre événement « PC Solidaire fête vos dons ». J’ai bien peur qu’elle manigance quelque chose de sombre qui nuira à mon image… (voir l’image d’illustration du portrait) » confesse-t-il en soupirant. « Que voulez-vous… Je n’ai pas eu voix au chapitre dans le choix de mes collaborateurs… »
Son image, justement, est importante. Avec un attrait particulier pour « tout ce qui sent apparemment très fort et très mauvais », pas toujours simple de bien présenter. Pour soigner son apparence et souligner son harnais phosphorescent « Best friend », il change tous les lundis de couleurs de bandana. « Mon préféré, c’est le bleu assorti à notre logo. On ne dirait pas, mais je suis très corporate et je prête très attention aux détails. C’est mon petit côté Karl Lagerfeld… »
De sa popularité grandissante, il acquiesce modestement: « Oui, il me faudra bientôt un agent… En plus, je n’ai pas signé d’autorisation à l’image, je l’ai déjà signalé… Mais contre une crêpe ou deux, tout peut se négocier. » Dans cet agenda bien chargé, il trouve heureusement encore le temps pour ses amis, qui lui rendent aussi visite à l’atelier. Son préféré ? « Yin, mon copain molosse. Lui aussi, je l’ai connu tout bébé. Maintenant, il fait deux fois ma taille mais ça ne m’impressionne pas. En plus, maintenant que je suis connu, j’ai un argument d’autorité supplémentaire. On gambade partout dans l’atelier, gare à vous dans l’escalier ! »
Une anecdote à nous partager ?
« L’équipe n’a que mon nom à la bouche. J’entends souvent « oui, on prévoit ces dons en Linux ». Au début, ça m’inquiétait : on veut me donner ? Mais à qui enfin ? J’ai déjà une famille pour la vie ! Maintenant, ça confirme ma théorie que je suis bel et bien un chien reconditionné et une star. La prochaine étape ? Avoir une étoile à mon nom sur Hollywood Boulevard. »
En dehors des chats, son Némésis, c’est l’aspirateur. « Je ne vois pas l’intérêt de faire tant de bruits pour en plus me râler dessus que je mets des poils partout… Je vois tout de plus bas et croyez-moi bien : je ne suis pas le seul responsable ! Il y a des poils bien trop longs pour m’appartenir. » Évidemment, on lui pardonne de bon cœur la délation. Au milieu de tous ces ordinateurs, il met de la vie et donne beaucoup d’amour sans – trop – compter. C’est peut-être bien lui, finalement, qui nous a tous adoptés.
Margaux Lidoine
Le portrait de septembre : Frédéric Anese, principal du collège Jules Ferry à Woippy
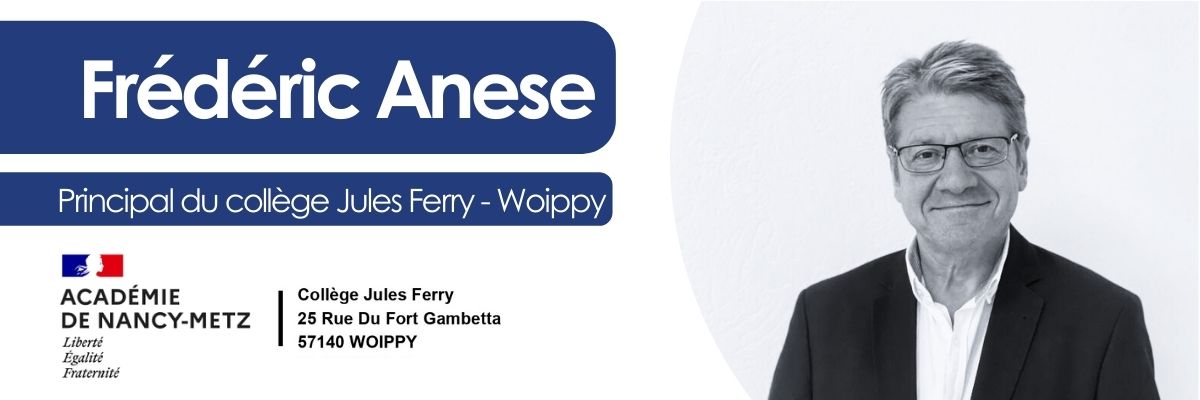
S’il a accepté l’entretien sans paraître hésiter, Frédéric Anese, de nature plutôt discrète, se présente d’emblée comme « seulement Frédéric Anese, principal du collège de Woippy ». C’est justement ce principal qui permet à PC Solidaire de lancer une opération d’envergure pour l’inclusion numérique des collégiens lorrains. Parce qu’il en a initié la démarche avec ses équipes pédagogiques, dans son collège classé « Réseau d’éducation prioritaire + » en mars dernier. Il me reçoit autour d’un café, ce mercredi après-midi de semaine de rentrée scolaire dont il est très satisfait, après un taux de réussite au brevet de 88 % dans son établissement. Alors, plutôt que répéter que ce format n’est « qu’un » remerciement pour son engagement dans cette aventure commune, nous en avons discuté, de cette rentrée… et j’ai parfois réussi à le faire dériver un peu, sur sa vie, la vie de l’homme de bientôt 58 ans derrière celle du chef d’établissement « au service de ses élèves ».
Des « envies d’espace »
L’enfant clarinettiste en harmonie, originaire de la Vallée de la Fensch et natif d’Algrange, s’est d’abord imaginé « dans la suite logique de ses études » musicien professionnel. Scolarisé au collège Taison puis interne au lycée Fabert, Frédéric Anese poursuit ses études avec une spécialité musicale. Diplômé du Conservatoire de Metz mais non-reçu aux concours d’orchestre qu’il passera par la suite, il emprunte en 1988 le chemin de l’enseignement, en tant que professeur d’éducation musicale en collège. Il y passe un peu plus de dix ans, notamment sur le bassin thionvillois et au collège La Milliaire à Thionville.
En parallèle professeur de clarinette en école de musique, il monte avec des amis des spectacles « type comédies musicales », avec des chorales allant parfois jusqu’à 200 élèves par établissement. Ce sont ces productions qui apportent les premières « envies d’espace, de liberté » , qui, peu à peu, vont le gagner. Le métier de personnel de direction, « où ces espaces sont plus vastes, l’activité intense » semble correspondre à son profil.
Les premiers pas de chef d’établissement
Concours en poche au début des années 2000, il est d’abord adjoint au collège Marie Curie (Fontoy), puis à la cité scolaire Hélène Boucher (Thionville) et à Georges de la Tour (Metz). Sa première prise de poste en tant que principal se fait au collège Louis Armand à Moulins-lès-Metz, une deuxième au collège Jean Rostand (Metz) et nous voilà à Jules Ferry (Woippy), en ce mercredi après-midi pour sa troisième rentrée dans l’établissement.
Son quotidien au travail, « c’est piloter, organiser, faire en sorte que tout ce qui est engagé fonctionne le mieux possible, autant dans la mise en œuvre des commandes institutionnelles que dans ce qui est mis en place pour aider au maximum nos élèves. » Concrètement, à Jules Ferry, il s’agit de renforcer l’apprentissage des fondamentaux, développer la culture, emmener les collégiens vers l’environnement numérique « outil indispensable à la réussite scolaire ou, en tout cas, à une insertion. Donc le plus tôt possible, faire en sorte qu’ils soient dotés du matériel mais aussi d’une formation à son utilisation ».
Aux côtés des équipes pédagogiques, ils observent les indicateurs et le quotidien de la vie de l’établissement, évaluent et réfléchissent ensemble à où leur « implication aura le plus de chance de faire en sorte que les élèves réussissent le mieux possible. »
De l’importance du bonheur
A la fin d’une journée de travail, il questionne les actions menées : « est-ce qu’on est dans la bonne direction ou faut-il la remettre en question ? Il faut un cap et le garder, tout en s’adaptant évidemment et pouvoir savoir si ce que nous mettons en place a du sens, quels en sont les résultats ? ».
Frédéric Anese puise sa motivation dans « l’espace » qu’il évoquait en début d’entretien mais surtout sa satisfaction à être au service : des élèves, de l’établissement, de l’éducation de manière générale et du service public, afin de tirer le meilleur profit des moyens à sa disposition. C’est là sa « quête de sens » et il s’y sent heureux, dans cet établissement « vivant et riche de diversité », d’implication du personnel dans de nombreux domaines : « ce perpétuel mouvement, c’est une vraie chance. »
Et le bonheur, c’est important… Son mot de rentrée aux élèves, d’ailleurs, l’évoquait : « Je leur ai dit que mon souhait, c’est qu’ils s’y sentent bien, voire même heureux. Quand on est heureux, c’est plus facile d’avoir du courage, on se sent bien, on a plus confiance en soi, on vit mieux chaque jour. »
Après le travail, musicien du rang
Mais quid de la musique, alors, dans tout ce mouvement et cette diversité quotidienne au travail ? Il n’a jamais arrêté de la pratiquer. Encore maintenant, tous les mercredis soirs, il s’entraîne avec un orchestre d’harmonie à Hagondange, sous la direction d’un chef « extraordinaire », Sébastien Beck. Le chef d’orchestre de l’établissement la journée passe alors le relai… « Être musicien de rang, s’asseoir, ne plus être aux commandes : ce n’est que du bonheur, d’être là pour soi et de lâcher prise après sa journée de travail. »
L’enfant de 8 ans qui « sifflait juste » d’après sa mère se voit mettre une clarinette entre les mains lorsque cette dernière l’emmène dans sa première harmonie : « à l’époque, on ne choisissait pas son instrument, c’était selon les besoins : il devait y avoir un pupitre où il y avait plus de besoins, alors j’ai commencé la clarinette. » L’ancien professeur se fait un plaisir de me raconter – car infiltrée depuis peu dans la région, après avoir plutôt côtoyé les bagads que les harmonies ! – l’histoire et l’importance de la musique dans les cités minières de la Vallée de la Fensch dans les années 75, des harmonies qui en sont nées, soutenues par la famille de Wendel.
Appréciant tous les registres musicaux, Frédéric Anese ouvre les différents « tiroirs » selon son état et son humeur. En ce moment « c’est comme le beau temps », rit-il en s’empressant de citer les Pink Floyd et Muse mais aussi de la musique classique et de la variété : « être ouvert à la culture, c’est aussi pouvoir être capable de piocher dans ce qui nous correspond le plus à l’instant T ».
Les prémices d’une action commune d’inclusion numérique
L’entretien s’écoule et nous voilà déjà sur la dernière question : quelle est l’histoire commune entre Jules Ferry et PC Solidaire ? Elle remonte, en réalité, à son premier poste d’adjoint à Fontoy : il y avait eu l’idée, avec un ami travaillant au Luxembourg, de créer une salle informatique avec des ordinateurs récupérés d’une banque « mais qu’avec du Linux, parce que l’intention était de montrer aux élèves qu’un ordinateur pouvait fonctionner sans pour autant être client de Microsoft et développer par la même occasion leur état d’esprit opensource ». Projet ambitieux mais difficile à mettre en œuvre alors. Puis à Jean Rostand, la prise de conscience de la difficulté d’accès au numérique des élèves s’accentue. En 2020, la crise du Covid éclate et je laisse la parole à Frédéric Anese pour les dernières lignes de cet entretien car ses mots sont forts, témoins d’une dure réalité et à la fois d’une belle initiative sans attente de retour ; ils ne méritent de fait aucune reformulation :
« Pour les élèves qui n’avaient rien, c’était vraiment compliqué. Les professeurs nous envoyaient le travail par mail, on arrivait au collège pour faire les photocopies puis on les postait aux familles concernées… Entre ceux qui recevaient l’information en instantané sur l’ordinateur, avec la possibilité d’avoir des aides sur Internet et ceux qui devaient attendre que le courrier arrive… C’était complètement inégal. J’ai réellement réalisé à quel point l’outil informatique est indispensable pour la réussite de la scolarité. Ce n’est pas parce qu’on n’en a pas qu’on ne peut pas réussir mais quand on n’en a pas, c’est plus compliqué. C’est facilitateur, encore une fois à condition de savoir l’utiliser et d’être formé à sa bonne utilisation.
Cette période de Covid a davantage ancré cette iniquité : on s’est dit, qu’est-ce qu’on peut faire pour eux ? Et à ce moment-là, il n’y avait pas de réponse. Il faut croire que sans qu’on se connaisse encore avec PC Solidaire, on s’est tous posés la même question au même moment. Et à un moment donné nos routes se sont croisées : vous aviez le stock, nous avions les élèves en attente. Il suffisait juste que nos routes se croisent. On a pu mettre en commun quand on s’est rencontrés.
Maintenant, c’est parti et c’est magnifique pour les élèves, je suis heureux, serein qu’on ait mis en place ce système là et je lui souhaite la plus longue vie possible.
Continuons à aider quand il est possible de le faire. Longue vie à cette association, à cette volonté du conseil d’administration et du collège d’aider les familles qui en ont le besoin avec PC Solidaire et à la MJC Boileau Pré-Génie qui est entrée récemment dans le dispositif pour y mettre de la formation : maintenant, la boucle est bouclée. Ce que j’espérais se produit : je suis serein, apaisé, ravi de voir qu’enfin on arrive à faire en sorte que nos élèves arrivent à avoir un ordinateur et une formation pour que les enfants dès la 6ème soient comme les autres, aient tous les mêmes chances et les mêmes outils pour réussir.
Voir que ce qu’on a eu en tête pendant de nombreuses années, ce qu’on n’a jamais pu faire se mettre en place, que quelque chose s’est enfin connecté et qu’aujourd’hui, c’est en train d’arriver : c’est fabuleux. On ne va pas en rester là, maintenant on veut en faire un principe, que tout élève boursier entrant à Jules Ferry se voie remettre un ordinateur au début de sa scolarité au collège… ».
M.L. – ça « pèse » ?
F.A.– Oui, ça pèse… et ça apaise.
Et cet apaisement est bien partagé côté PC Solidaire…
Margaux Lidoine
Le portrait de juin : comme le colibri, avec Lilo, Sophie fait “sa part”

La légende amérindienne du colibri
Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! »
Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
Passionnée par son travail comme l’infatigable colibri incarné par Lilo, Sophie Bodin définit sa liberté en citant Nietzsche : “apprendre à danser avec ses chaînes”. Tête de proue du navire Lilo.org, moteur de recherche solidaire qui affichera bientôt les 5 millions d’euros récoltés gratuitement pour des associations par ses utilisateurs, la Présidente directrice générale se déclare d’entrée “pas de nature bavarde”. Après plus d’une heure d’entretien pour la première édition de ce format “Le portrait du mois” par PC Solidaire, nous en rions ensemble : pas de nature bavarde, cela dépend des sujets.
De Londres à Buenos Aires…
Au début des années 90, la Britpop mène une jeune Sophie à effectuer sa terminale au lycée français de Londres. On l’imagine aisément déambuler dans l’arc-en-ciel de couleurs de Camden Town. Ce séjour, qui aurait dû avoir la douceur d’une fin d’adolescence sur des airs d’Oasis et de Blur, se heurte à un fossé culturel inattendu. La chaleur humaine de son nord originaire n’y est pas.
Quelques années plus tard, diplômée avec succès du prestigieux CELSA, elle redonne sa chance au voyage : expatriée à Buenos Aires, dans une ville au premier abord chaude et suffocante où elle ne se projette pas… Pourtant, quand elle évoque avec émotion ces presque cinq années qui “dans une vie, comptent double, triple, voire quadruple”, c’est la chaleur humaine qui transperce ses mots, cette “proximité latine” et profonde gentillesse. Ces rencontres qui ne l’ont jamais montrée du doigt pour n’être pas native argentine, et qui la reconnaissent toujours quand elle retourne dans ce qui est devenu, avec le temps, son “deuxième pays”. Son coeur y est encore, nous le sentons, et la marraine de sa plus si “petite fille” de 12 ans également. L’Argentine, c’est à la fois un “prisme sur sa vie d’avant”, et des liens qui paraissent éternels.
Orange, puis Innocent
De retour en France après cette expérience réussie dans la grande consommation en Amérique du Sud, elle se fait une place chez France Télécom, devenu depuis Orange. Cinq années passent, mais la nostalgie de l’Argentine, associée aux produits de consommation du quotidien, demeure. Le chemin bascule à nouveau quand une collègue lui fait goûter un smoothie Innocent. Interpellée par le produit, elle se rend sur le site web de la marque, clique sur l’encart “Job aux Maldives”, et rit de s’être fait avoir.
Si le job aux Maldives est une utopie, Innocent cherche cependant à lancer la marque en France, et c’est ainsi que Sophie rejoint une petite équipe marketing d’abord, qui grandira avec elle. Onze années passent cette fois, et forte du succès de l’opération, elle quitte les rangs “avec le sentiment du devoir accompli”. La maternité, l’âge, une soif d’apprendre encore hors des produits de consommation : tout une conjoncture qui éveille le désir d’impact dans son travail plus fortement encore, une véritable quête de sens. Où et comment mettre à profit son expérience, sa vision, sa passion effrénée du travail pour réellement changer les choses ? C’est à ce moment que Lilo vient à sa rencontre.
La tête de Lilo.org et la force du coeur
Il lui faut deux ans pour assumer son titre de “Présidente directrice générale”. Être une femme PDG, dans l’univers dans lequel évolue Lilo, facile, répond-elle. Facile, une fois levés les freins qu’elle s’était elle-même mis, inconsciemment. Son premier atout, c’est cette intuition qui, selon elle, n’en est pas vraiment : mais plutôt le fruit de l’expérience emmagasinée tout au long de sa carrière, qui lui permet d’avoir une vision plus aiguisée des risques et opportunités, afin de prendre les décisions qui lui incombent. Du chemin déjà bien entamé par Lilo à son arrivée, Sophie perçoit “un peu innocemment au départ”, un boulevard. Il n’y a “qu’à” faire changer le produit mis dans le caddie des utilisateurs de moteur de recherche. Avant de réaliser que cette vision, propre aux produits de consommation, est biaisée dans le monde numérique : les choix sont, pour la plupart, tous imposés aux utilisateurs. Son premier challenge sera donc de rendre visible cette possibilité de choix.
Lilo, moteur de recherche, français, éthique et solidaire oui, mais Sophie y appose sa patte, une vision plus large, pour que Lilo devienne un outil rendant gratuitement le don accessible à tous. Par cette plateforme incroyable de plus de mille projets soutenus, témoins d’engagement quotidien et véritable “source d’espoir”, mais pas seulement : un podcast, un forfait téléphonique qui récompense la sobriété, un module d’achat solidaire… Il faut incarner la force, la puissance de l’action collective, matérialiser son poids. “Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n’abandonne jamais”, déclarait Xavier Dolan à Cannes. Sophie lui répondrait certainement oui, mais rêvons, osons, travaillons, et n’abandonnons jamais ensemble.
La puissance du collectif
Parce qu’ensemble, pour Sophie, c’est d’abord l’équipe portant Lilo à ses côtés. Un état d’esprit familial où règne, à son image, la bienveillance et l’entraide. Si son statut la veut tête de proue du navire, elle n’hésite jamais à mettre la main à la pâte : un léger souci technique ? Sans même y réfléchir, le temps du rétablissement, elle prend en charge la modération des commentaires et messages sur les réseaux sociaux, touchée par la bienveillance qu’elle y reçoit. Ne reçoit-on pas, justement, ce que nous donnons ?
Parce qu’ensemble, pour Sophie, c’est également avec les utilisateurs de Lilo. Ils sont l’élan du souffle du changement. Quand à Noël, Lilo fait “descendre le web dans la rue”, ils répondent présents et rédigent de nombreux messages à l’attention des oubliés de la rue, trop souvent isolés pendant les fêtes de fin d’année. Émue, oui, quand elle lit les mots d’une personne autrefois confrontée à cette vie dans la rue : il souhaitait aussi transmettre un peu de chaleur, dire qu’il n’oublie pas, ne les oublie pas. La boucle est bouclée. L’écosystème solidaire se tisse à travers la toile du web et concrètement, dans la vraie vie, au travers de ces actions menées de front. Des centaines, des milliers, des millions de colibris qui, ensemble, œuvrent à éteindre l’incendie de la forêt et font leur part (lire l’encart ci-dessus), déversant leurs gouttes d’eau, symboliques et réelles.
A quoi rêvait l’enfant ?
Enfant, Sophie n’a jamais su précisément ce à quoi elle se destinait : danseuse, peut-être ? Plus tard, en entretien d’embauche, elle se trouve “un peu bête” quand elle ne sait pas répondre, ni définir ses passions. La danse lui a passé, sa vie quotidienne est “normale”, elle y trouve son bonheur au-delà des imperfections de chaque jour. Sa passion, c’est son travail. S’y sent-elle heureuse aujourd’hui ? Comme ses passions, le bonheur au travail lui est une notion complexe à appréhender. Mais, “chemin faisant, chemin qui se bâtit en même temps qu’elle le découvre”, au fil de l’eau et des liens amicaux qui se nouent, elle répond humblement : elle ne voudrait pas être ailleurs, ni faire autre chose. La voilà, sa conception du bonheur.
Un coup de coeur commun
Terminant l’entretien sur le partenariat avec PC Solidaire, Sophie fait écho aux mots échangés précédemment : c’est encore une histoire de rencontres, qui semble commune évidence. Dans les échanges, elle confie, amusée, s’être presque trouvée de nouveau en Argentine. La chaleur humaine, les valeurs et enjeux partagés, les intersections de vie. Lilo évoluant dans l’univers des GAFAM, les contraintes y sont parfois nombreuses. Sophie cite alors Nietzsche “La liberté c’est de savoir danser avec ses chaînes”. Nous apprenons en effet, chacun de part et d’autre à Paris et à Metz, à danser avec nos chaînes. “Mais si on peut danser à deux, ça sera encore mieux !” conclut-elle. Et nous vient alors l’idée fugace que Sophie n’a jamais arrêté de danser, nous entraînant avec elle dans son sillage. Nietzsche aurait probablement ajouté, non sans ironie, qu’“il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile qui danse”.
Margaux Lidoine